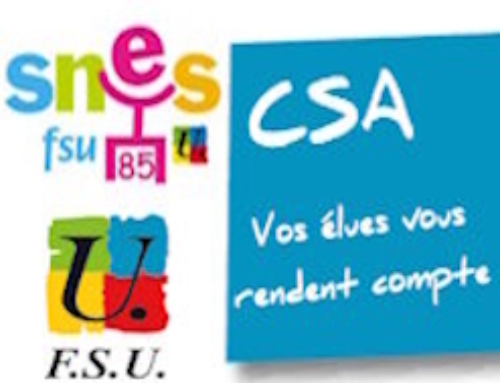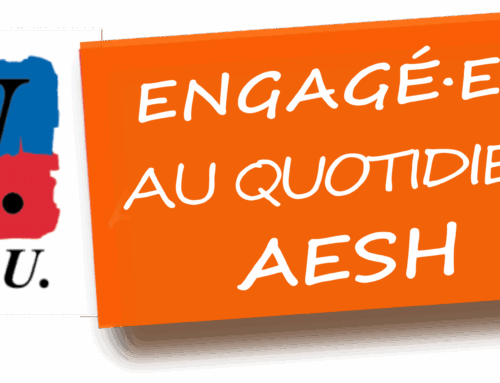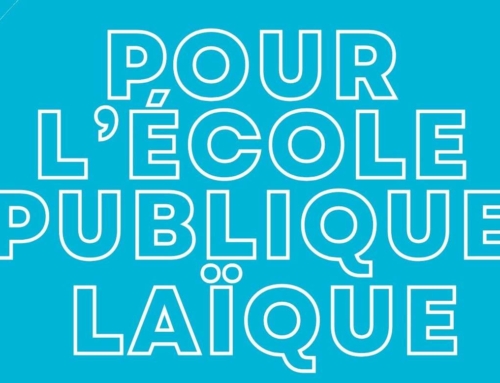Si les 143 000 AESH ont su se rendre indispensables au fonctionnement de l’école inclusive, leur métier, marqué par l’indignité salariale et la précarité, reste mal défini et (re)connu. Pourtant, ces personnels ont beaucoup à dire de leurs pratiques et gestes professionnels.
Interview de Frédéric Grimaud
Frédéric Grimaud, PE et chercheur associé à l’équipe Griffe de Aix Marseille Université, auteur de l’ouvrage « AESH, un vrai métier » (éditions Syllepse)
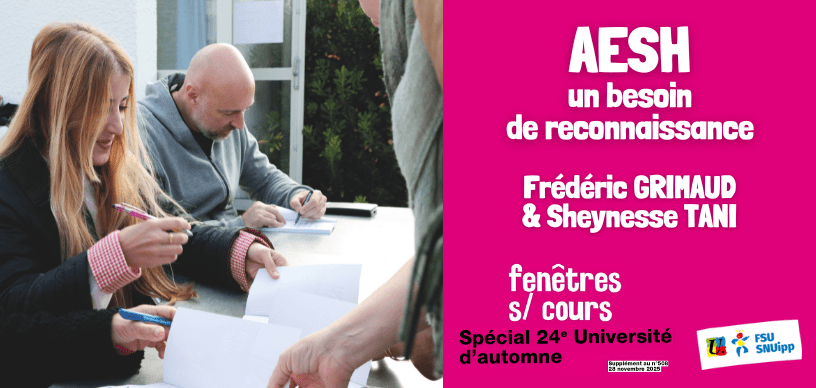
AESH, EST-CE UN MÉTIER OU UN TRAVAIL ?
AESH est à la fois un métier et un travail, au sens où il est réalisé par des personnes qui se sentent dépositaires des bons gestes professionnels. Exercé au sein d’une institution dotée d’une histoire et d’une culture propres, il s’inscrit dans une filiation depuis les travailleuses familiales des années 1920 qui s’occupaient des personnes impotentes, puis les aides ménagères aux personnes invalides dans les années 1950 et plus tard les AVS.
S’il est plutôt récent dans sa forme scolaire, AESH s’inscrit dans l’historique d’un métier nourri du souci des personnes les plus écartées de la norme, celles en situation de handicap. Les gestes professionnels des AESH consistent en « interactions de tutelle », à l’interface entre l’enfant et sa tâche, qu’elle soit scolaire ou sociale. Les gestes d’accompagnement vont du lavage des mains à la reformulation de consignes et aux actions pour enrôler l’élève dans l’activité.
DANS QUELLES CONDITIONS CE TRAVAIL DOIT-IL ÊTRE EXERCÉ ?
Les prescriptions cadrant le métier d’AESH sont floues. Accompagner ou coopérer sont des actions peu définies et peu opérantes, y compris en termes d’organisation du travail. La chaîne hiérarchique est difficile à comprendre, ce qui crée un inconfort professionnel. Les conditions de travail sont marquées par l’intériorisation du risque de prendre des coups et subir des blessures. Cette réelle pénibilité physique est particulièrement mal reconnue.
Ensuite, il s’agit de travailler à deux, ce qui n’a rien d’évident. D’autant que le temps institutionnel nécessaire à la concertation PE/AESH n’existe pas. 70% des AESH se disent bien intégrées dans leur établissement et 80% déclarent avoir de bonnes relations avec les enseignants mais elles vivent des micro-exclusions. La moitié des AESH déplorent ne pas avoir de chaise ou de place attitrée dans la classe, très peu disposent d’un casier en salle des maîtres. La moitié seulement déclare participer aux temps conviviaux organisés par les enseignants.
“Les AESH se positionnent comme concepteurs et conceptrices de leurs tâches”
EN QUOI LE TRAVAIL RÉEL EST-IL SUJET DE CONTROVERSES ?
Les controverses sont un invariant du travail. Deux personnes qui ont le même métier ne le réalisent pas de la même manière. Discuter des normes et valeurs de leur travail montre que les AESH se positionnent comme concepteurs et conceptrices de leurs tâches. Trois controverses vives peuvent être citées en exemple. À des fins de sécurité, faut-il doter un enfant au comportement éruptif d’un dossard pour assurer sa surveillance en récréation ou faut-il éviter tout signe distinctif au titre de l’inclusion ? À des fins d’hygiène, faut-il aider un élève d’ULIS à se laver les mains ou s’obliger à seulement lui montrer comment faire pour le guider vers l’autonomie ? Quand d’autres élèves de la classe présentent des problèmes de comportement, faut-il que l’ARS intervienne de manière préventive ou faut-il se consacrer exclusivement à l’élève « notifié » ? Ces débats n’ont pas à être tranchés, les avis divergents se fondent tous sur une conception du travail bien fait.
QUELLES ÉVOLUTIONS SOUHAITENT LES PERSONNELS ?
Les AESH ressentent un affect contradictoire entre un très fort sentiment de fierté et celui d’être institutionnellement malmenées. D’où la demande d’un statut qui réponde à leur besoin de légitimité. Symboliquement, elles revendiquent une place dans une salle des personnels qui ne soit plus exclusivement une salle des maîtres. Il y a également un besoin de reconnaissance de la pénibilité, physique et psychologique, mais aussi émotionnelle générée par le sentiment d’impuissance à aider les élèves accompagnés.
L’amélioration de leurs conditions de travail suppose de les associer à l’organisation matérielle de l’école. Plus précaires que les enseignants, les AESH bénéficient paradoxalement d’une grande liberté d’exécution de leurs missions, ce qui est intéressant à préserver. Participer à l’élaboration d’un référentiel métier leur permettrait d’exposer les débats qui traversent leur profession et de clarifier la chaîne hiérarchique, les prescriptions, la formation initiale et continue. Et enfin reconnaître leur métier par une qualification.
Témoignage
« Adopter la juste posture ». Cette préoccupation est au cœur des interventions de Sheynesse Tani, AESH-co – comme « collectif » – auprès des élèves présentant des troubles du spectre autistique de l’ULIS de l’école Saint-Joseph Servières à Marseille (Bouches-du-Rhône). Pour ces enfants « qui ont du mal avec le changement » et dont certains ne sont pas entrés dans la communication verbale, il faut sans cesse « adapter l’aide aux besoins ». Le planning très rigoureux et ritualisé qui offre un cadre sécurisant aux élèves est certes un point d’appui pour leur encadrement par les adultes. L’alternance précise des temps collectifs et individuels, la cadence minutée des activités balisent ainsi l’activité de la PE et des quatre AESH qui, chaque demi-journée, travaillent en relations duelles.
Le registre des gestes professionnels de Sheynesse, selon que les activités sont plutôt consacrées aux acquisitions scolaires ou à la motricité et à la sociabilité, embrasse un large éventail : « reformuler les consignes, organiser et soutenir la communication à l’aide de pictogrammes, encourager l’autonomie et développer l’habilité… voire comprendre et réguler les crises quand surgit l’inattendu qui déstabilise ou que s’accumule anxiété ou fatigue. Toujours à l’initiative pour proposer une nouvelle activité ou aménager l’organisation de la classe », précise Sheynesse qui apprécie les échanges, toutefois trop souvent informels, avec l’enseignante et les autres AESH pour savoir si elle « en fait trop ou pas assez », s’il convient selon la situation « d’aider ou seulement accompagner ». Pour « ce métier tellement beau où on se sent si utile et où on donne énormément sur le plan humain », l’accompagnante phocéenne souhaiterait un statut qui reconnaisse « qui on est », une formation adaptée et un salaire digne qui ne l’oblige pas à envisager des vacations dans le médico-social. Ce serait le moins que puisse faire l’institution pour « nous [les AESH] qui sommes un des piliers de l’école inclusive et sans qui les PE seraient bien seuls ».
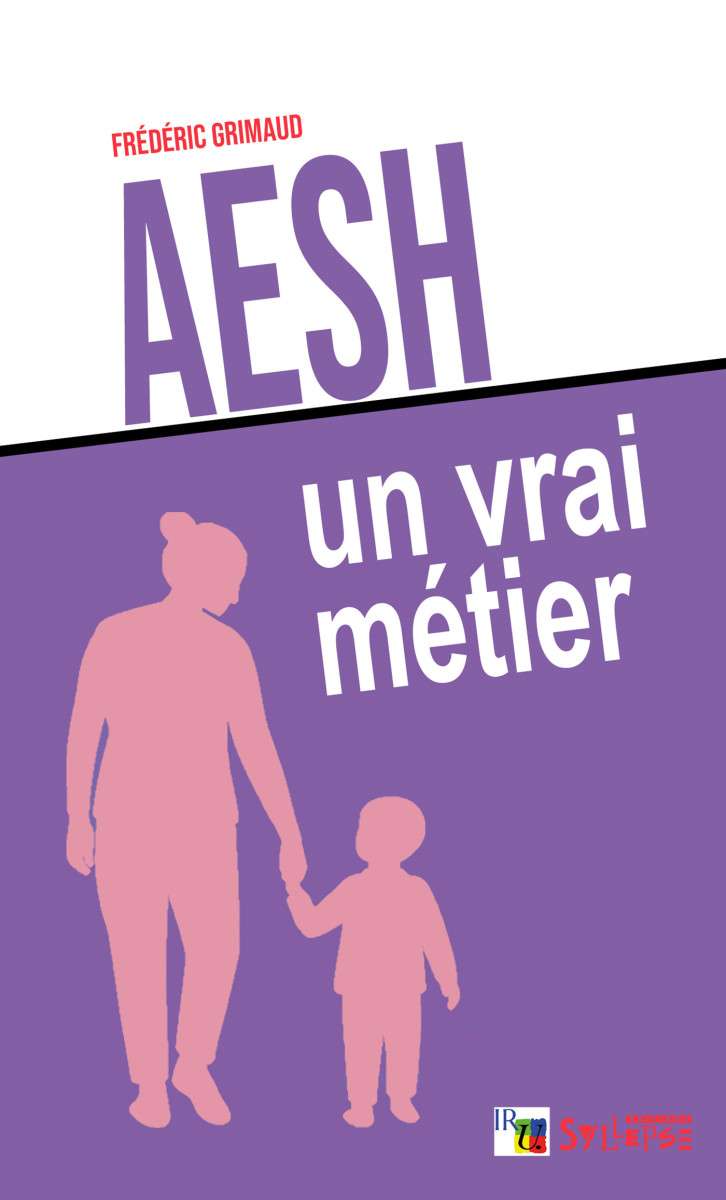
 Vendée
Vendée